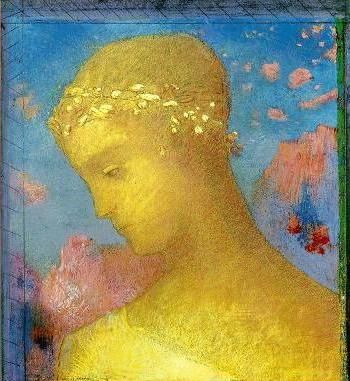Dans le silence des mots, Joëlle Gardes, éditions de l’Amandier, 2008
Le titre du recueil est l’expression exacte du paradoxe entretenu tout le long du recueil comme un véritable fil conducteur. Dès le poème liminaire se font ainsi face l'animé et l'inanimé, " l'oubli des voix " et le souffle des choses ", le bruit et le silence : " Je veux entendre …le silence des mots". On trouvera plus loin des oppositions douloureuses comme celles de l'hier et du présent : " autrefois et aujourd'hui les tapis lavés dans l'eau salée / l'odeur des beignets et celle de l'ambre … " puis, au cœur du sujet, avant la chute finale, celle de la vie et de la mort : " Les bouquets sont pour les tombes " que symbolise, .à plusieurs reprises, le contraste entre la lumière et l'obscurité, et plus concrètement encore, celui qu'expriment la neige et l'ombre. L'allitération n'hésite pas à accompagner l'expression d'un chant sans lyrisme à proprement parler : " Le noir qui avale l'espace au crépuscule est troué de l'éclat de quelques plaques blanches et de l'envol d'un merle au ras du potager endormi. "
Joëlle Gardes est si près des choses qu'elle peut les chanter en oubliant de parler d'elle. L'oxymore permet finalement d'accéder à la vérité et s'exprime dans certaines formules véritablement magiques. C'est ainsi qu'en face du titre de la partie finale et décisive, on peut lire : " Les yeux se ferment pour mieux voir ce qui ne se voit pas ", qu'il faut attendre les toutes dernières pages pour que le néant l’emporte sur les oppositions et que se boucle, dans le privilège de l’oubli évoqué dès les premiers mots et dans les dernières lignes encore, une pensée apaisée par la résolution des contraires.
Avant cette victoire finale, la tension entre dans la définition même de l’œuvre et ne cesse que dans l'expression de l'unique qui, comme le bleu, rapproche les contraires : " Aujourd'hui comme autrefois le bleu immobile mouvant." Joëlle Gardes cherche l'unicité et l'aime comme une source même de poésie.
Avec une thématique qu'on pourrait qualifier de banale, si elle n'avait pas la beauté d'une simplicité voulue, l'auteure recrée un monde poétique, le revisite sans cesse, avec un regard nouveau tantôt joyeux tantôt désespéré. La quête, si elle tend à se passer des mots ou plutôt de leur bruit, affirme, dans le premier volet éponyme, par sept textes nommés " scansion", son besoin d'émotion à travers la musique, le rythme d'un dit sous forme de questions ou d'assertions révoltées. Celui-ci trouve ses propres marques dans des versets qui, tutoyant la prose, avortent ou alternent avec des vers brefs. Il se fait aussi dans l'alternance de textes longs et de textes plus courts et comme dans le refus de règles internes précises.
Ces choix n'empêchent pas un travail récurrent sur les sons. On entend, par exemple, les assonances faire écho au mot " silence " lui-même : " je contemple la neige qui m'engourdit de son silence " et les allitérations exprimer la liquidité de la Méditerranée : " plaine liquide mer du milieu ". Ainsi l'eau avec la vague qui " jaillit ", le vent " qui rend fou " témoignent de " la fureur cachée " et font partie comme les autres éléments d'un ensemble d'actants.
On peut parler, dans cette poétique, d’une véritable présence au monde réel, qu’il soit proche ou qu’il soit ailleurs, présence presque à chaque page inspirée et expirée : " J'avale le monde dans l'air que je respire ".
Mais la diversité évoquée par la richesse étonnante des mots est révélatrice d’un malaise et c’est en arrivant à faire l’économie du langage que Joëlle Gardes peut trouver, dans un certain silence, sa voix et sa véritable musique. Dans l'élaboration de l'œuvre, la variété des thèmes et du vocabulaire propre à en balayer le champ, si elle exprime certainement un mal-être, n'est là que pour accéder à l'unique. L'économie de mots, témoigne, dès les premières pages, de cette philosophie du texte.
Ainsi certains textes sont-ils d’une concision étonnante et d’autres se relâchent dans un réalisme en crescendo révélateur d'une colère qui doit s'exprimer pour sortir de l’étouffement.
Tout d'abord, l'expression de la nature, définie dans sa renaissance, se fait conjointement avec celle de ses contraires : la guerre, ses morts et ses ruines urbaines.
Les phénomènes naturels sont ici " la seule réponse, l’équilibre ultime du monde ". L’auteure s’applique, à force de touches poétiques, à nous transmettre son état de grâce. En effet, il faut " deviner le bourgeon sous la neige ", assister à l'envol des mouettes, noter que " la main attrape un papillon et se couvre de poussière dorée ". Et c'est la saison nouvelle qui " engloutit l'arrière-saison " et nous offre les plus belles pages du recueil avec, par exemple, " la main abandonnée hors de la barque ". Il faudrait citer encore nombre de vers d'une grande beauté et ne pas se contenter d'évoquer " la fournaise d'août " par la phrase : " La mouche bourdonne une dernière fois puis s'immobilise " ou bien la présence de la Sorgue qui nous rappelle René Char.
Et s'il y a, ensuite, chez Joëlle Gardes, une fascination de la couleur exprimée dans de nombreuses récurrences comme celle de la neige, c'est déjà un parti pris de réalisme. La poète colore, comme dans un réflexe synesthésique, les sentiments eux-mêmes : " le visage de la colère est rouge ou blanc et celui de la peur jaune ". Le rouge étonne, plus loin encore, livré en anaphore dans un magnifique camaïeu: c'est Marrakech !
Mais, comme chez beaucoup d'autre auteurs, la couleur-clé est le bleu avec l'espérance qu'il suggère puisqu'il " a envahi la maison, le golfe, les collines" jusqu'à la mer, un " Bleu de l'indistinction des êtres et des choses " qui est un trait d'union entre aujourd'hui et autrefois.
Une partie des réponses semblent bien se trouver dans cette paix possible.
Les mots de couleur ne sont pas seuls à enrichir ici la poétique, il y a aussi un lexique souvent recherché, voire un lexique de mots rares : " mots difficiles apophatique et diastique azalaïe et anhinga…" comme également des noms sonores : " curcuma safran cumin ".Mais quand le réalisme l'emporte et qu'il fait crescendo, avant même l'installation d'un malaise qui va jusqu'à la présence de la mort, le silence éponyme de l'œuvre l'emporte. Puis ce malaise se manifeste non seulement à travers des champs lexicaux et des vocables choisis mais aussi dans le rôle avoué de l'écriture.
Enfin, si Marrakech a gardé ses secrets, c'est en Tunisie que se fait l'expérience de la souffrance et de la finitude : " quand le temps qui nous reste…se réduit au maintenant ou jamais ". Et ce sont " ossements sous la dalle ", " urnes vierges de leurs cendres …dispersées sur la mer " qui ramènent à l'anonymat, au néant. Après des descriptions qui touchent au baroque, l'écriture peut se faire minimaliste car " la vie s'en va à pas feutrés ". C'est aussi par la symbolique d'une métaphore filée que se manifeste le mal-être et cela dès le début du recueil. : " l'encre salit les doigts ", " écriture devenue illisible ". Mais si " les mots jetés sur la page ne sont que reflets menteurs ", comment se fera la communication de la beauté et de la vérité ?
En effet, accablé par l'ennui, l'homme mène une vie ponctuée par " la répétition des actes", la " répétition des paroles ", " la répétition de soi ", par " les questions sans réponses ". La nature n'est plus alors d'aucun secours car " celui qui écrit du fond de sa détresse ignore les saisons " et, peu à peu, s'installe parallèlement à l'écriture le besoin de silence comme en témoigne par endroits une économie de mots remarquable. Il y a même un certain renoncement à la musique ainsi que cela arrive dans l'extrême concision. Dès le début Joëlle Gardes a l'intuition de ce besoin quand elle écrit :
" Rêve de mots sans musique
Sans choc ni cliquetis de sonorités
De mots pour l'œil et pour l'intelligence
Rêve de mots dont la musique sera une épure
Comme les mathématiques
D'une émotion sans émotion
D'une passion sans passion… "
Elle sait déjà, veut nous faire savoir qu'il y a " le silence éternel ", " le rien, où aucune voix ne surgira ". Et le livre s'est écrit, malgré tout, car elle avoue préférer encore le bruit et même la laideur des cacophonies. Aussi " la main se rebelle, biffe et rature "-t-elle. Joëlle Gardes réussit ainsi par un tour de force, dans un renoncement à la parole, une de ses plus belles pages où des phrases nominales brèves ne gênent pas le travail sur les sons et résument, en une dizaine de vers, la vie humaine jusqu'à leur chute apollinarienne : " Puis le linceul les têtes ébouriffées de chrysanthèmes ".
Cette dernière partie fait le point. L'auteure y prend sa respiration pour parler de la vieillesse, du jour " où elle sera livrée au calme des souvenirs " avant la mort qui viendra, du moment de sa vie où " l'esprit tâtonne à la recherche du mot ". On pense à Nathalie Sarraute à la recherche du mot " tamaris ".
A l'occasion de cette fin du recueil, le lecteur se voit surpris car il est là question de maladie, d'hôpital, d'un mal-être à la fois physique et moral, et comprend alors la portée autobiographique de ce qu'il vient de lire. Puis, après avoir réussi encore à parler, Joëlle Gardes va se taire mais elle évoque auparavant, au climax de son réalisme et dans une veine villonnienne augmentée de l'expérience des camps, les vers, le sang et la mort.
Les mots pour le dire, avec " la main impuissante ", ne sont qu’une solution provisoire et le silence de la fin peut, une fois l’œuvre achevée, être vécu comme une délivrance.
A la fin, précédant le " silence des mots " qu'il faut comprendre comme un groupe nominal au génitif à la fois objectif et subjectif - on lit en effet : " nous leur disons ce que nous avons tu au milieu de paroles vaines " -, la fusion des contraires va s'effectuer pour que cette poésie tendue vers l'impossible trouve son sens.
Alors, après " la rencontre de la mer et du ciel sur l'horizon ", cette lumière qui rend aveugle va jaillir " dans notre nuit " avant que " les paupières ( ne ) se ferment ".
France Burghelle Rey